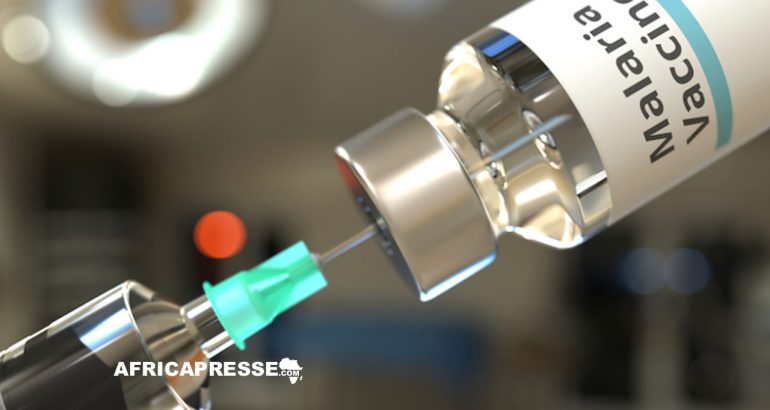Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme fait face à un déficit financier préoccupant pour son prochain cycle de financement. Lors de sa conférence de reconstitution des ressources à Johannesburg, l’organisation n’a mobilisé que 11,34 milliards de dollars sur les 18 milliards initialement prévus pour la période 2027-2029, créant un manque à gagner de près de 7 milliards de dollars.
Ce déficit résulte principalement du retard pris par plusieurs bailleurs historiques. Si les États-Unis maintiennent leur leadership avec une promesse de 4,6 milliards de dollars, le Royaume-Uni a réduit sa contribution à 850 millions de livres, contre 1 milliard de livres lors du cycle précédent. La France, le Japon et la Commission européenne n’ont pas annoncé de contribution immédiate, reportant leurs décisions à une date ultérieure. Seuls quelques pays comme l’Inde et l’Irlande ont augmenté leur participation, tandis que le secteur privé montre un engagement croissant.
Ce recul des engagements s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu où les crises multiples concurrencent les budgets d’aide au développement. Créé en 2002 comme mécanisme innovant de financement multilatéral, le Fonds mondial représente aujourd’hui le principal bailleur dans la lutte contre ces trois pandémies. Son modèle, initialement porté par un consensus international fort, doit désormais composer avec des priorités sanitaires mondiales fragmentées et des contraintes budgétaires accrues chez les donateurs traditionnels.
Les conséquences de ce sous-financement sont déjà programmées. Le Fonds mondial devra réduire ses coûts de 20% dès 2026 et a commencé à informer les pays bénéficiaires d’ajustements dans les subventions en cours. Son directeur exécutif, Peter Sands, estime que ce contexte marque la fin du modèle basé sur une dépendance excessive à l’aide extérieure et plaide pour une transition accélérée vers l’autonomisation financière des pays concernés.
Cette situation intervient à un moment critique où des avancées médicales prometteuses pourraient significativement réduire les infections et les décès. Le Fonds mondial, qui estime avoir sauvé 70 millions de vies depuis sa création, finance actuellement des traitements antirétroviraux pour 25,6 millions de personnes, des soins contre la tuberculose pour 7,4 millions de patients et la distribution de 162 millions de moustiquaires imprégnées contre le paludisme.
La structure future des allocations pourrait évoluer vers une priorisation accrue des pays à faible revenu les plus touchés, avec des mécanismes différenciés pour les économies émergentes. La capacité du Fonds à maintenir son niveau d’intervention dépendra des engagements complémentaires attendus et de l’adaptation de son modèle opérationnel. Ces décisions détermineront directement la trajectoire des objectifs mondiaux de lutte contre ces pandémies qui continuent de faire des ravages, particulièrement en Afrique subsaharienne.