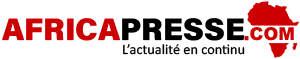L’information principale est l’inquiétude qui a dominé l’ouverture du 39e sommet de l’Union africaine, samedi 14 février à Addis-Abeba : celle d’un péril imminent pesant sur le multilatéralisme et la paix mondiale. Dans un contexte de recomposition brutale de l’ordre international, marqué par des interventions militaires contestées et la multiplication des coups de force, les dirigeants du continent ont appelé à une prise de conscience collective. La cérémonie inaugurale a ainsi servi de tribune à un diagnostic sévère sur l’érosion des cadres de coopération établis depuis 1945.
Au cœur des discussions à huis clos, les chefs d’État et de gouvernement planchent sur une cascade de crises simultanées qui fragmentent le continent. Les travaux, qui se poursuivent ce dimanche, sont accaparés par l’escalade des combats dans l’est de la République démocratique du Congo, la guerre civile qui ravage le Soudan depuis près d’un an, la reprise des hostilités au Soudan du Sud, et l’expansion continue de la menace terroriste du Sahel jusqu’au bassin du lac Tchad. La géopolitique des présences était elle-même révélatrice des tensions : seule une cinquantaine de dirigeants ont fait le déplacement, avec une moitié seulement de chefs d’État, les autres s’étant fait représenter par leurs Premiers ministres. Parmi les absents notables figuraient le Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, le Congolais Denis Sassou-N’Guesso et le Rwandais Paul Kagame, dont le pays est directement impliqué dans la crise congolaise. À l’inverse, les généraux Mamadi Doubouya (Guinée) et Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon), auteurs de putschs récents mais ayant depuis organisé des élections controversées, ont fait leur entrée, illustrant les ambiguïtés de l’institution panafricaine face aux ruptures constitutionnelles.
Ce sommet s’inscrit dans un climat international délétère où les règles semblent voler en éclats. Les interventions militaires unilatérales des États-Unis ou d’Israël, menées sans mandat onusien, et les actes d’ingérence étrangère qui se multiplient sur le sol africain, ont servi de toile de fond aux discours. À cela s’ajoute la défiance régionale incarnée par le retrait des régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la Cédéao, fragilisant davantage les architectures de sécurité ouest-africaines. C’est dans ce contexte que le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a dressé un constat sans fard d’un « bouleversement de l’ordre international », appelant à une intégration politique et économique accrue du continent, présentée non plus comme une option mais comme « une question de survie ».
Les perspectives tracées lors de cette ouverture dessinent une feuille de route ambitieuse mais semée d’embûches. Le président sortant de l’UA, l’Angolais João Lourenço, a plaidé pour une défense intransigeante du multilatéralisme, seul « garant de la paix et de la sécurité mondiale ». Mais c’est l’intervention du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a cristallisé l’attention en dénonçant l’absence d’un siège permanent pour l’Afrique au Conseil de sécurité. « Nous sommes en 2026, pas en 1946 », a-t-il lancé, donnant du poids à une revendication historique du continent. La passation de pouvoir au Burundais Evariste Ndayishimiye, nouveau président en exercice de l’UA, replace désormais la barre sur sa capacité à transformer ces déclarations en actions concrètes, alors que les lignes bougent aussi bien sur les champs de bataille que dans les couloirs des Nations unies.
Derrière les grands discours, ce sont les éclairages plus discrets qui révèlent les fractures internes. Si la cérémonie d’ouverture a mis en avant l’unité de façade autour du multilatéralisme, la réalité des salles de réunion est plus complexe. Le dossier congolais, notamment, cristallise les tensions : la présence de Félix Tshisekedi contraste avec l’absence de Paul Kagame, régulièrement accusé par Kinshasa de soutenir la rébellion du M23. Par ailleurs, si les généraux putschistes ont été réintégrés de fait après leurs élections, le silence de l’UA sur les conditions de ces scrutins et sur le rétrécissement de l’espace démocratique ailleurs sur le continent reste assourdissant. Le sommet d’Addis-Abeba se termine donc sur une question fondamentale : l’Union africaine parviendra-t-elle à peser sur la scène internationale pour défendre ses intérêts, alors qu’elle peine encore à imposer une ligne commune face aux crises qui déchirent ses propres États membres ?