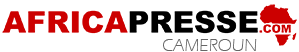En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a décroché un quatrième mandat à 83 ans, avec un score officiel de 89,77 % des voix, une victoire qualifiée de « coup KO » par l’institution électorale. De l’autre côté, au Cameroun, Paul Biya, âgé de 92 ans, a été réélu pour un huitième mandat avec 53,66 % des voix. Dans les deux cas, cet écrasant avantage électoral interroge : est-ce le signe d’un peuple adhérant pleinement à ses dirigeants ou celui d’un système verrouillé ?
En Côte d’Ivoire, l’environnement électoral a été marqué par l’élimination d’opposants comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam avant même la campagne, une participation souvent très faible (autour de 50 % ou moins de 20 % dans certaines régions) et une machine électorale qualifiée de sur-mesure. Au Cameroun, malgré un score plus modéré, l’opposition dénonce des fraudes massives, des bourrages d’urnes et des coupures d’Internet dans les zones anglophones. Dans les deux pays, ce ne sont pas seulement les résultats qui interpellant, mais le cadre dans lequel ces résultats ont été obtenus.
Ces deux régimes inscrivent leur longévité politique dans un contexte marqué par la personnalisation du pouvoir et l’affaiblissement des institutions. En Côte d’Ivoire, Ouattara, arrivé en 2010 avec l’image d’un renouveau démocratique, a utilisé des modifications constitutionnelles et des interprétations opportunes des textes pour prolonger son mandat. Au Cameroun, Biya gouverne depuis 1982, s’appuyant sur un parti hégémonique et une administration soumise, tandis que la région anglophone est en proie à un conflit meurtrier et que l’économie stagne. Dans ces deux pays, l’alternance reste un horizon vide.
À moyen terme, la persistance de ces régimes pourrait engendrer une usure profonde du pacte social. Les jeunes, majoritaires dans la population, semblent de plus en plus désenchantés face à des dirigeants « indispensables » mais épuisés. En l’absence d’alternance crédible et de renouvellement institutionnel, le risque va au-delà de la frustration : il devient socio-politique. Le manque de relève organise un vide politique, tandis que l’attente d’un changement sincère grandit.
La longévité au pouvoir n’est pas le signe d’une sagesse politique mais plutôt d’un blocage démocratique. Au-delà des cas ivoirien et camerounais, ce modèle de gérontocratie révèle un malaise plus large : l’impossibilité pour de nombreux pays d’Afrique de combiner stabilité et renouvellement politique. Ce que font Ouattara et Biya n’est pas « simplement » de rester à leur poste, c’est de confondre leur personne avec l’État. Cette confusion affaiblit la gouvernance et met en péril la cohésion du pays. Pour une jeunesse qui réclame des institutions fortes et transparentes, le message est clair : l’absence de transition vaut mieux que la prolongation d’un pouvoir usé. Le véritable changement ne viendra pas du nombre de mandats mais de l’instauration d’une culture de l’alternance et de la responsabilité politique.