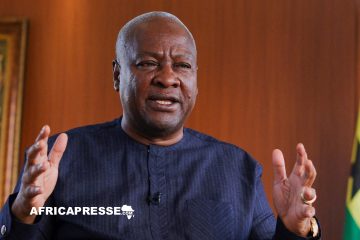Six personnes ont été tuées, dont deux brûlées vives, le 30 juin dans le village de Gasarara, près de Bujumbura. Elles ont été extraites de leurs foyers par un groupe de jeunes armés qui les accusaient de sorcellerie, après plusieurs décès jugés inexpliqués dans la région. Un acte d’une violence extrême, qualifié de « justice populaire inadmissible » par les autorités provinciales.
Selon des témoins cités par l’AFP et confirmés par des images diffusées sur les messageries, les agresseurs seraient des Imbonerakure, membres de la ligue de jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ces jeunes hommes ont battu, lapidé puis immolé certaines victimes, provoquant six morts et un blessé grave. Trois autres personnes ont été sauvées de justesse par l’intervention des forces de l’ordre. Douze suspects ont été arrêtés, mais leur identité n’a pas été révélée.
Les lynchages pour « sorcellerie » ne sont pas rares au Burundi, où la mort inexpliquée d’un proche est souvent interprétée comme le résultat d’un ensorcellement. Mais cet épisode sanglant intervient dans une zone perçue comme un bastion de l’opposition, ce qui alimente les soupçons de motivations politiques. Si les autorités locales ont tenté de dissocier l’événement de tout enjeu partisan, la présence présumée des Imbonerakure, souvent accusés de violences politiques, relance le débat sur l’usage de la peur et de la terreur pour contrôler certaines régions.
Le gouvernement a promis une enquête et annoncé des arrestations, mais l’absence de poursuites dans des cas similaires par le passé nourrit le scepticisme. Les lynchages liés à des accusations de sorcellerie ne donnent que rarement lieu à des condamnations effectives, surtout lorsque les auteurs sont affiliés à des structures proches du pouvoir. Ce climat d’impunité renforce les pratiques de justice extrajudiciaire et dissuade les familles des victimes de porter plainte.
Le recours à l’accusation de sorcellerie s’enracine dans les traditions burundaises, mais il est aujourd’hui récupéré dans certains cas comme outil de répression sociale ou politique. Le silence des plus hautes autorités nationales sur cette affaire, combiné à la lenteur judiciaire habituelle, laisse planer un doute sur la volonté réelle de briser ce cycle de violences. Ce drame soulève à nouveau la question du rôle des Imbonerakure dans le maintien de l’ordre informel, et de la frontière floue entre milice partisane et appareil sécuritaire.
Si le ministre de l’Intérieur s’est rendu sur les lieux et a condamné les faits, la réaction des autorités reste à ce stade essentiellement déclarative. Le défi est désormais d’engager une réponse judiciaire crédible et transparente, pour réaffirmer que nul ne peut se faire justice soi-même – y compris ceux liés au parti au pouvoir. À défaut, ces actes barbares risquent de se reproduire, dans un climat de peur entretenu par l’absence de sanction et le poids des croyances.