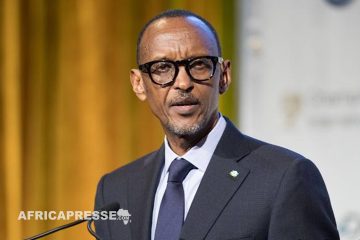Le 7 avril 2025 marque le début des 31e commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Chaque année, ces cérémonies s’étendent sur 100 jours, rendant hommage aux plus de 800 000 victimes des massacres de 1994. Pour les rescapés, cette période est particulièrement éprouvante, ravivant des souvenirs douloureux et des traumatismes encore vifs. Pour surmonter cette épreuve, les survivants se rassemblent en groupes, créant des espaces de solidarité et de soutien mutuel.
Les commémorations commencent souvent par des rassemblements où la solidarité joue un rôle clé. Par exemple, l’association Avega, regroupant les veuves du génocide, a organisé des rassemblements dans les provinces du Rwanda. Joséphine Murebwayire, 71 ans, rescapée et mère ayant perdu tous ses enfants, témoigne de l’importance de ces moments. Pour elle, survivre au génocide et maintenir sa mémoire vivante est une manière d’honorer les disparus et de porter la résilience pour les générations futures. Ces rassemblements, empreints de solidarité, permettent aux survivants de s’unir et de surmonter ensemble la période de commémoration.
Le Rwanda vit chaque année cette période de commémoration dans un contexte marqué par l’histoire récente et les cicatrices encore visibles du génocide. En 1994, un gouvernement extrémiste Hutu a orchestré l’extermination de la population tutsi, provoquant un traumatisme national. La réconciliation entre les communautés et la reconstruction du pays ont été au cœur des efforts du gouvernement rwandais post-génocide. Cependant, pour les rescapés, les commémorations restent un rappel lancinant de la souffrance passée et du besoin constant de soutien émotionnel.
Les 100 jours de commémorations sont plus qu’un acte de mémoire : ils constituent un défi émotionnel pour ceux qui ont survécu. Le soutien collectif et la solidarité entre les rescapés deviennent essentiels pour faire face au stress post-traumatique. L’association Avega, par exemple, encourage les survivants à se soutenir mutuellement pendant cette période, à travers des visites régulières et des prières. Les rescapées, comme Valérie Mukabayire, ancienne présidente d’Avega, soulignent l’importance de rester unies et de se rappeler la force qu’elles ont montrée dans les années qui ont suivi le génocide.
Le poids psychologique des commémorations est particulièrement lourd, car plus d’un quart des rescapés souffrent encore de stress post-traumatique majeur. Les symptômes de ce traumatisme sont exacerbés pendant les 100 jours de souvenir, période durant laquelle les rescapés revivent les horreurs du génocide. Les organisations comme Avega jouent un rôle crucial en fournissant un espace de solidarité et de résilience, permettant aux survivants de se soutenir et de garder leur espoir vivant malgré les cicatrices émotionnelles.
Les commémorations du génocide rwandais illustrent la force collective et la résilience des survivants face à des traumatismes historiques profonds. Bien que ces moments soient difficiles, ils sont aussi l’occasion pour les rescapés de renforcer leur solidarité, de trouver du réconfort les uns auprès des autres, et de continuer à porter le flambeau de la mémoire. Les cérémonies sont, pour beaucoup, un moyen de se rappeler non seulement la tragédie, mais aussi la résistance et l’espoir qui ont permis au Rwanda de se relever.