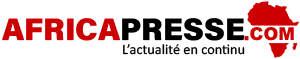L’intervention militaire américaine au Venezuela, qui a abouti à la capture du président Nicolás Maduro, constitue un tournant géopolitique majeur. Cet acte, perçu comme une violation flagrante du droit international et de la souveraineté nationale, dépasse le cadre régional et vient immédiatement résonner dans le conflit russo-ukrainien, où il est scruté pour ses implications stratégiques et ses possibles conséquences en cascade.
L’opération prive en effet la Russie d’un allié politique et économique clé en Amérique latine. Moscou perd un partenaire diplomatique qui, à l’Assemblée générale des Nations unies, s’était abstenu ou avait refusé de condamner son invasion de l’Ukraine. Sur le plan économique, la coopération, bien que limitée, concernait principalement le secteur pétrolier et des contrats militaro-techniques, offrant à Moscou un levier d’influence dans l’arrière-cour des États-Unis. La mainmise américaine sur Caracas neutralise désormais ce point d’appui.
Cette évolution s’inscrit dans une rivalité de longue date entre Washington et Moscou, où le Venezuela jouait le rôle de pivot anti-américain pour la Russie. Depuis l’ère Chavez, Caracas s’était progressivement alignée sur Moscou, achetant des armes, attirant des investissements et servant de contrepoids à l’hégémonie régionale des États-Unis. Pour la Russie, cet allié symbolisait sa capacité à projeter son influence hors de sa sphère post-soviétique traditionnelle, dans un contexte de confrontation globale avec l’Occident.
À court terme, cette perte n’est pas considérée comme une catastrophe stratégique pour le Kremlin, qui a diversifié ses partenariats, notamment vers la Chine. Cependant, l’événement crée un précédent doctrinal lourd de sens. En validant par les armes le principe des « sphères d’influence » – ici la doctrine Monroe réaffirmée avec force par Washington –, les États-Unis offrent, selon certains analystes, une forme de justification rétroactive aux actions de la Russie dans son voisinage. Moscou pourrait y voir un feu vert implicite pour poursuivre ou intensifier ses offensives en Ukraine, arguant que les grandes puissances agissent selon les mêmes règles de realpolitik.
La réaction initiale de Moscou a été étonnamment mesurée. La condamnation, formulée par le ministère des Affaires étrangères et non par le Kremlin directement, évite toute escalade verbale. Cette retenue stratégique s’explique par la volonté russe de préserver un dialogue bilatéral crucial avec Washington, notamment sur les dossiers économiques et ukrainiens. Le Kremlin, familier des revirements du président américain Donald Trump, ne souhaite pas provoquer de rupture qui nuirait à ses intérêts à long terme.
Du côté ukrainien, la réaction a été à la fois ironique et inquiète. Le président Volodymyr Zelensky a implicitement comparé le sort de Maduro à celui qu’il souhaiterait pour Vladimir Poutine, tout en laissant transparaître une crainte fondamentale : celle que cette opération ne consacre une normalisation dangereuse du renversement par la force des régimes jugés indésirables. Cette crainte est partagée par des experts qui estiment que l’action américaine, en banalisant l’ingérence armée, fragilise l’ordre international fondé sur le droit et pourrait encourager d’autres puissances à agir avec plus d’impunité dans leurs propres zones d’influence.
Au-delà du rapport de forces immédiat, l’épisode vénézuélien marque ainsi un recul du cadre multilatéral. Il consacre le retour d’une logique de blocs et de chasses gardées, où la souveraineté des États moyens devient négociable. Pour l’Afrique, souvent courtisée par ces mêmes puissances, la leçon est claire : dans un monde où les grands acteurs revendiquent ouvertement leurs pré carrés, la marge de manœuvre pour les pays du Sud se réduit, et leur alignement diplomatique devient un enjeu de sécurité existentielle. L’affaire vénézuélienne n’est donc pas un incident isolé, mais un symptôme d’un système international en pleine régression vers la loi du plus fort.