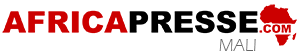Fruit de six mois de consultations nationales et dans la diaspora, le projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation sera officiellement remis au président de la Transition, le 22 juillet, à Bamako. Ce document, censé refonder le cadre du processus de paix au Mali, marque une rupture nette avec l’accord d’Alger de 2015, jugé inadapté par les autorités actuelles.
Présentée comme une initiative inclusive et centrée sur les réalités maliennes, la Charte repose sur les principes de la nouvelle Constitution de 2023, notamment l’intégrité, la justice et la solidarité. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a qualifié cette restitution de « rendez-vous historique de la souveraineté ». Selon lui, le texte traduit la volonté du gouvernement de reprendre le contrôle du processus de réconciliation, jusque-là largement dicté par des médiations internationales.
Cette initiative intervient alors que la situation sécuritaire reste tendue, en particulier dans le nord et le centre du pays. Depuis le retrait des forces de l’ONU et la fin de l’accord d’Alger, les groupes armés reconstituent leurs positions, et les affrontements avec l’armée se sont multipliés. Dans ce climat, la Charte se veut un outil de refondation de l’État, visant à restaurer la cohésion nationale sur des bases perçues comme plus légitimes.
Prévue initialement pour plus tôt dans le mois, la remise du document a été repoussée afin de permettre un élargissement des consultations et une révision approfondie du contenu. La Commission de rédaction, dirigée par l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, affirme avoir privilégié l’inclusivité et l’ancrage local à la précipitation. Le résultat, selon ses membres, serait un texte représentatif de toutes les sensibilités du pays.
La prochaine étape sera celle de l’appropriation. Les autorités annoncent une campagne de communication nationale pour expliquer la Charte et convaincre les citoyens, les partis politiques et les chefs communautaires de son bien-fondé. Reste à voir si cette nouvelle boussole parviendra à s’imposer dans un paysage politique fragmenté, et si elle pourra combler le vide laissé par la fin du cadre d’Alger, sans relancer les tensions.
En misant sur une solution dite « endogène », Bamako affirme sa souveraineté mais prend aussi un risque : celui de s’isoler davantage des partenaires régionaux et internationaux qui avaient porté l’accord de 2015. Sans leur soutien et sans consensus national clair, la mise en œuvre de cette Charte pourrait se heurter à des résistances. À ce stade, le texte suscite autant d’espoir que de scepticisme.