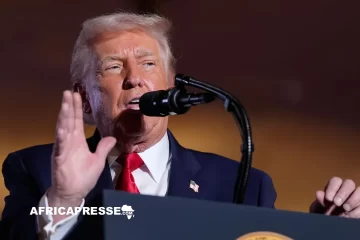Les récentes déclarations du membre du Congrès américain Scott Perry, suggérant que l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) aurait financé le groupe terroriste Boko Haram au Nigeria, ont déclenché une véritable tempête. L’accusation a provoqué une série de clarifications, de débats enflammés et des tensions diplomatiques entre les États-Unis et le Nigeria. Cette situation a mis en lumière des questions complexes sur les flux financiers internationaux et la responsabilité des agences d’aide humanitaire dans des zones de conflit.
Scott Perry, député républicain de Pennsylvanie, a critiqué l’USAID lors d’une audition à la Chambre des représentants, la qualifiant de “caisse noire financée par les contribuables pour des détournements de fonds”. Bien que l’USAID ait nié ces accusations, la mission américaine au Nigeria a été contrainte de publier une déclaration sur les réseaux sociaux, affirmant que des mécanismes rigoureux de suivi étaient en place pour garantir que l’aide atteignait bien ses bénéficiaires. Cette réponse, loin de rassurer, a alimenté les soupçons concernant la transparence des fonds alloués à l’aide humanitaire dans des régions instables comme le nord-est du Nigeria.
Le Nigeria est plongé dans une guerre de longue haleine contre Boko Haram, un groupe terroriste responsable de la mort de plus de 50 000 personnes et du déplacement de millions d’autres. Depuis 2009, la violence de Boko Haram a déstabilisé la région, forçant des millions de Nigérians à fuir vers des pays voisins comme le Niger, le Tchad et le Cameroun. Dans ce contexte, des accusations de soutien financier à ces terroristes par des acteurs étrangers, y compris des organisations humanitaires, ont été régulièrement évoquées. Le sénateur Ali Ndume a ainsi souligné que l’implication d’ONG dans ce genre de pratiques n’était pas une nouveauté, en rappelant la méfiance persistante des autorités locales vis-à-vis de certaines organisations internationales.
La situation pourrait avoir de lourdes conséquences sur les relations diplomatiques entre le Nigeria et les États-Unis. Si les accusations de financement indirect de Boko Haram par l’USAID s’avèrent fondées, cela mettrait en lumière un échec majeur dans la gestion des fonds d’aide humanitaire. Le Nigeria, déjà fragilisé par des années de violence terroriste, pourrait redoubler de vigilance à l’égard des aides étrangères, ce qui affecterait la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme.
Des experts et responsables nigérians ont exprimé leurs inquiétudes depuis longtemps concernant le financement de Boko Haram. Le général Christopher Musa, chef de l’armée nigériane, a récemment révélé que des combattants de Boko Haram avaient été capturés avec des fonds en provenance de puissantes nations étrangères. De même, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Bolaji Akinyemi, a évoqué des témoignages de villageois dans l’État de Borno concernant des livraisons d’armes et d’argent en provenance d’acteurs étrangers, ce qui renforce l’idée d’un soutien international implicite à Boko Haram.
En dépit des clarifications américaines, le débat sur la transparence des fonds internationaux reste vif au Nigeria. Les analystes, comme Kabiru Adamu, directeur de la société de conseil en sécurité Beacon Consulting, soulignent que les accusations de Perry, bien que politisées, pointent une réalité : des puissances étrangères ont historiquement soutenu des groupes terroristes. Le futur de l’aide américaine au Nigeria pourrait être redéfini, et la question de savoir où va l’argent investi par des pays comme les États-Unis dans des zones de guerre pourrait devenir un sujet de plus en plus sensible, notamment au regard de la situation en Afrique.