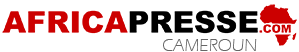Arrivé à la tête de l’État, le 6 novembre 1982, à la suite de la démission d’Ahmadou Ahidjo et en conformité avec les dispositions constitutionnelles de l’époque, le chef de l’État camerounais fête le quarantième anniversaire d’un bail qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Évocation des moments clés d’une très longue carrière politique.
1962 ou 1982 ?
C’est une question de prisme. Selon qu’on considère son arrivée dans les hautes sphères de l’État, ou son accession à la magistrature suprême du Cameroun. Octobre 1962, quand, de retour de ses études supérieures en France, muni, dit-on, d’une précieuse recommandation du très influent politicien français Louis-Paul Aujoulat adressée au premier président du pays, Ahmadou Ahidjo, Paul Biya est nommé Chargé de mission à la présidence de la République. Soixante déjà. Ou alors, le 6 novembre 1982, lorsque, à la suite de l’annonce de la démission d’Ahidjo le 4 novembre, le Premier ministre en fonction depuis 1975 accède aux plus hautes charges de l’État en vertu des mécanismes constitutionnels connus depuis la modification de la loi fondamentale intervenue en juin 1979. Quarante ans se sont écoulés.
Quelle que soit la borne historique choisie, et même si la référence aux fonctions présidentielles demeure prégnante, on ne peut que convenir d’une ascension fulgurante dans sa marche vers les cimes de l’État de celui qui, en octobre 2018, remportait sa septième élection présidentielle, après celles du 14 janvier 1984, du 24 avril 1988, du 11 octobre 1992, du 11 octobre 1997, du 11 octobre 2004, et du 9 octobre 2011.
Débuts mouvementés
Les débuts pourtant ne furent guère faciles pour Paul Biya, fraîchement porté à la tête de l’État, ce 6 novembre 1982. Une succession de crises. La première éclate en 1983, lorsque s’impose dans le débat politique la question de la primauté du parti sur l’État, ou l’inverse. Ahmadou Ahidjo, qui n’est plus président de la République, garde néanmoins les rênes de l’Union nationale camerounaise (UNC, parti unique) et prétend qu’il revient à l’État d’appliquer la politique arrêtée par cette formation politique. Ce à quoi Paul Biya rétorque que c’est à l’État (à son chef) de définir la politique de la Nation.
La joute est vive. Et conduit le tout nouveau président à poser deux actes d’une portée politique majeure : l’organisation de l’élection présidentielle du 14 janvier 1984 pour s’offrir une légitimité par voie de vote, et son élection au poste de président de l’UNC le 14 septembre de la même année, qui lui permet de contrôler le parti. Or, entre les deux dates, survient, le 6 avril, une tentative de coup d’État, conduite par des éléments de ce qui est alors la « garde républicaine », majoritairement issus de la partie septentrionale du pays et présentés comme les partisans d’Ahmadou Ahidjo. Ce-dernier, se confiant en janvier 1983 au journaliste Henri Bandolo, auteur du désormais classique La flamme et la fumée paru en 1986, n’avait pas tari d’éloges pour son successeur. « Je fais entièrement confiance au président Paul Biya. C’est moi qui l’ai formé aux plus hautes responsabilités de l’État. Il a travaillé 15 ans à mes côtés de façon loyale et irréprochable. C’est, en outre, un grand patriote. Je sais qu’il saura défendre les intérêts de notre pays. Je l’avais nommé Premier ministre parce qu’il avait toute ma confiance. Et je lui ai renouvelé cette confiance en lui passant le relais à la tête de l’État. Je l’ai fait au mieux des intérêts de notre pays. Il le méritait. Il m’a été fidèle et loyal. C’est un homme honnête, intègre et compétent. Je le connais mieux que personne », martelait, alors, le chef de l’État démissionnaire…
L’épreuve des « villes mortes »
D’autres moments critiques de la vie socio-politique surviennent plus tard. L’année 1990 apparaît comme un marqueur historique. Le temps est à la bataille pour la restauration du multipartisme reconnu par la Constitution dans un pays qui vit, dans une contradiction assumée, sous le parti unique, d’abord l’UNC depuis 1966, puis le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), dès le 24 mars 1985. Secoué de l’intérieur par des fortes pressions politiques d’une part, et forcé de s’adapter à la nouvelle donne de la coopération avec la France, qui, lors du sommet de la Baule, conditionne désormais son aide à la démocratisation, le régime vacille. Le président Biya, s’ajuste finalement. Une série de lois, votées par l’Assemblée nationale lors d’une session dite « des libertés » en décembre 1990, restaure le multipartisme et instaure d’autres libertés dont celle de la presse et des associations.
Pourtant, la demande politique locale est loin d’être satisfaite. Elle s’exprime bruyamment en 1991. La rue est son territoire d’expression favori où se déroulent des manifestations au cours desquelles l’on exige l’organisation d’une « Conférence nationale souveraine ». C’est le temps des « villes mortes » où les populations, notamment dans la ville de Douala, sont tenues de n’exercer aucune activité. C’est aussi le temps de la « désobéissance civique » qui se traduit par le refus de payer les taxes à l’État. Très vite, les conséquences économiques se révèlent désastreuses pour le pays. Dans un premier temps, le président Biya, déclare, péremptoire, le 17 juin 1990 : « La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. »
Mais devant le durcissement du ton des insurgés, il consent à prescrire la tenue d’une Conférence « tripartite » rassemblant les partisans du pouvoir, les représentants de la « société civile » et les figures de l’opposition afin de trouver une voie de sortie de crise et mettre fin aux « villes mortes ». Les travaux qui se déroulent à Yaoundé, entre le 30 octobre et le 17 novembre, aboutissent à des résolutions censées apaiser le climat de surchauffe politique dont la révision de la Constitution, l’élaboration d’un nouveau Code électoral et même d’un texte portant « statut de l’opposition ». Quelques mois plus tard, les « villes mortes » ont vécu. Le président Biya a-t-il pour autant vaincu ?
Les émeutes de 2008
Une certitude : Douala est apparue au fil de ces années comme la place forte des forces d’opposition au régime en place. Cette réputation résiste au temps. En février 2008 éclatent les « émeutes de la faim ». Présentées comme la protestation contre la « vie chère », à la suite d’une augmentation des prix des denrées sur les marchés, des manifestations de forte ampleur se déroulent dans la capitale économique. Le mouvement gagne Yaoundé. Sans avoir la même envergure qu’à Douala. Le pouvoir panique et réprime sans ménagement les insurgés. Dans son discours de circonstance, le président tance ceux qu’il considère comme les instigateurs de la protestation et les taxes d’« apprentis-sorciers ».
Il y a dans l’air l’idée d’une révision de la Constitution, en vue de mettre fin à la limitation des mandats du président de la République. Ce qui donne lieu à des interprétations faisant le lien entre ce projet juridico-politique et les manifestations organisées à Douala et Yaoundé. Quel crédit accorder à une telle hypothèse ? Toujours est-il que l’exécutif présente à l’Assemblée nationale, lors de la session de mars 2008, un projet de loi qui pulvérise les dispositions constitutionnelles qui limitent à deux le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Désormais, la loi fondamentale stipule que « le président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable ». Les contempteurs du chef de l’État considèrent que c’est « la voie ouverte à une présidence à vie ». Au sein du régime, l’on prête au président Biya une manœuvre visant à contenir les luttes de succession qui s’intensifient alors, dans la perspective de son éventuelle retraite politique au terme d’un mandat qui court jusqu’en 2011…
Le combat contre Boko-Haram
Trois ans plus tard, la secte islamiste Boko Haram défraie la chronique dans la région de l’Extrême-Nord du pays, même si les spécialistes situent à l’année 2009 les premiers indices de ses activités en territoire camerounais. L’État du Cameroun se voit imposer une guerre asymétrique. Certains observateurs n’hésitent pas à indexer, sans preuve, des forces extérieures qui auraient décidé d’ébranler le régime en place. Paul Biya fait preuve de fermeté. Autour de la lutte sans merci menée contre la secte, se coalisent l’armée camerounaise et la Force multinationale mixte. Progressivement, Boko Haram perd du terrain.
Résurgence du « problème anglophone »
Fin 2016, le président Biya doit faire face à la résurgence, apparemment inopinée, du « problème anglophone ». Des manifestations sont menées par des avocats qui exigent notamment la traduction en anglais des documents relatifs à l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Quelques semaines plus tard, c’est au tour des enseignants d’exprimer leurs revendications dans la rue. Les villes de Bamenda (capitale de la région du Nord-Ouest) et Buea (chef-lieu de la région du Sud-Ouest), abritent les protestations. Très peu d’analystes envisagent, à ce moment, la montée en puissance des revendications visant à mettre fin à ce qui est perçu comme le malaise anglophone, qu’une partie de l’élite des régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest assimile à la marginalisation.
C’est que, apparu comme un sujet de préoccupation depuis la première édition de la All Anglophone Conference en 1993, le « problème anglophone » semble n’avoir pas été pris en charge par le régime en place, à la juste dimension des défis qu’il charrie, suscitant un procès en indifférence contre le gouvernement. Depuis lors, deux tendances sont apparues : celle, « modérée », qui revendique un retour au fédéralisme à deux États, dont un anglophone et un autre francophone ; et celle, « radicale », qui prône la sécession des régions anglophones du pays. Face à la dégradation de la situation ayant engendré une crise sécuritaire du fait de l’activité des combattants séparatistes armés qui font face aux forces de défense, le président Biya prescrit la tenue d’un « Grand Dialogue National » du 30 septembre au 4 octobre 2019. Il s’agit, selon le chef de l’État, de « trouver une solution au problème anglophone ». Trois ans après la grand-messe de Yaoundé, les résultats sont mitigés, et la crise est loin d’être endiguée.
Succès diplomatique dans l’affaire Bakassi
C’est pourtant dans cette partie anglophone du pays que le président Biya avait remporté un succès diplomatique significatif au début des années 2000. Octobre 2002. La Cour internationale de la justice rend un verdict par lequel elle reconnait l’appartenance au territoire camerounais de la presqu’île de Bakassi dans la région du Sud-Ouest. Six ans plus tard, le 14 août 2008, le Cameroun retrouve sa souveraineté sur cette portion du territoire qui, depuis 1993, faisait l’objet de visées annexionnistes de la part du Nigéria voisin. La gestion de ce dossier par Yaoundé et Abuja est saluée comme un modèle de règlement pacifique des conflits en Afrique. Dès le début de la crise, Paul Biya, plutôt que d’engager son pays dans une guerre aussi incertaine que ruineuse, choisit de porter l’affaire devant la CIJ et ne change pas de cap.
Au total, « L’affaire du différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria constitue pour le premier un véritable succès tant sur le plan juridique que judiciaire. Sur le plan juridique, la quasi-totalité des demandes faites par le Cameroun ont été approuvées. Ainsi, les trente-trois localités autrefois contestées dans la zone du lac Tchad, ont été rétrocédées au Cameroun le 13 juillet 2004. La presqu’île de Bakassi, point d’orgue de ce contentieux, a connu le même sort et le retrait des forces nigérianes y compris son administration est effectif depuis l’Accord de Greentree (2006, Ndlr). Sur le plan judiciaire, on pourrait affirmer sans risque de se tromper que la quasi-totalité des exceptions soulevées par la partie camerounaise a été acceptée par la Cour », explique le professeur Jean-Louis Atangana Amougou, agrégé des facultés de Droit, enseignant à l’Université de Yaoundé II-Soa.
Le Cameroun, les crises économiques et le FMI
On en oublierait presque le poids des crises économiques durant les quarante ans d’exercice du pouvoir du président Biya. Dès 1987, après avoir écarté le scénario d’un recours au Fonds monétaire international (FMI), le chef de l’État fait volte-face. Depuis lors, le pays vit au rythme ininterrompu des programmes économiques conclus avec les institutions de Bretton Woods, avec leur lot de conditionnalités, de contraintes et de pressions. Ce qui impose au Cameroun une série de réformes en matière de bonne gouvernance d’autant plus incontournables que le pays a mauvaise réputation en la matière. En 1998 et 1999, le Cameroun est considéré, comme « champion du monde de la corruption », selon l’« indice de perception de la corruption » de Transparency International. « Trophées » plutôt embarrassants pour le chef de l’État qui, dès novembre 1982, avait placé son règne sous la double exigence de la rigueur dans la gestion et de moralisation des comportements.
De fait, les enjeux de la coopération avec le FMI sont tels que le pays n’a plus jamais véritablement retrouvé la plénitude de sa souveraineté en matière d’élaboration de sa politique économique, en dépit de l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative en faveur des pays pauvres et très endettés en avril 2006, et la production par le gouvernement d’un Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) en 2009, puis d’une Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) en 2020. La preuve : le Cameroun a conclu avec le FMI, en 2021, un nouveau programme économique triennal adossé sur une Facilité élargie de crédit (FEC), et un Mécanisme élargi de crédit (MEDC).
Répondant, le 21 juillet 1990, à une question du journaliste français Yves Mourousi, Paul Biya affirmait : « Je voudrais que l’histoire retienne de moi l’image de l’homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité ». L’Histoire jugera, le moment venu.
RFI