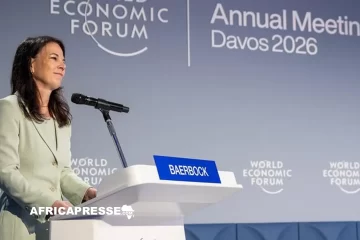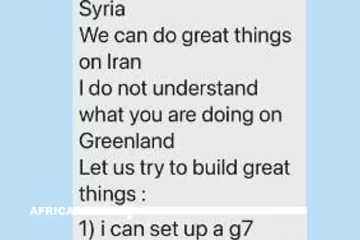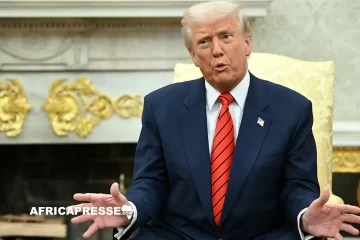Lorsqu’un pape décède, une série de rites rigoureusement codifiés entre en action pour combler la vacance du siège apostolique. Ce processus, bien orchestré, commence dès l’annonce du décès et se poursuit par des étapes minutieuses, allant des prières collectives à l’élection d’un nouveau pontife. Ces rituels ont pour but de maintenir l’ordre au sein de l’Église catholique, tout en permettant aux dignitaires religieux et aux fidèles de se recueillir.
Après l’annonce de la mort du pape, commence une période de neuf jours de prières et de messes, appelée « novemdiales », organisée au Vatican et dans le monde entier. Ces prières sont un moyen pour les catholiques de se rassembler spirituellement en hommage au défunt. Les obsèques, quant à elles, sont programmées entre quatre et six jours après le décès, afin de permettre à tous ceux qui souhaitent rendre hommage au pape de venir se recueillir devant son corps. Cette phase est un moment d’introspection religieuse et collective, marqué par un protocole strict. Depuis l’année dernière, le pape François a simplifié ces cérémonies, optant pour un enterrement plus sobre et sans exposition du corps.
Le cardinal Camerlingue, élu pour la première fois en 2019, joue un rôle crucial pendant cette transition. Actuellement occupé par le cardinal irlandais Kevin Farrell, il est le seul à conserver ses fonctions après le décès du pape. En sa qualité de « pape par intérim », il gère les affaires courantes et convoque les « congrégations générales », des réunions de cardinaux destinées à organiser la suite du processus. Ces congrégations permettent de préparer l’élection du prochain pape et de prendre des décisions administratives importantes pour l’Église durant la vacance du siège.
Les cardinaux, réunis sous la direction du cardinal Camerlingue, se rencontrent régulièrement pour débattre de l’avenir de l’Église. Chaque cardinal est invité à s’exprimer lors de ces réunions, afin de partager ses idées sur les défis et les besoins de l’Église, ainsi que sur le profil du futur pape. Ces débats ont une grande importance, car ils permettent de définir les critères de l’élection papale en fonction des enjeux internes et externes de l’Église. Ainsi, lors de la renonciation de Benoît XVI en 2013, c’est au cours de ces rencontres que le cardinal Jorge Bergoglio s’était distingué par la clarté de ses idées et son charisme.
Une fois les congrégations terminées, le conclave peut débuter, généralement entre 15 et 18 jours après la mort du pape. Ce processus consiste à élire un nouveau souverain pontife parmi les cardinaux électeurs, soit ceux âgés de moins de 80 ans. Le dernier conclave, qui a élu le pape François en 2013, n’a duré que deux jours, mais certains conclaves peuvent durer plus longtemps. Au total, environ 137 cardinaux, répartis dans 71 pays, sont appelés à participer au vote. Ce conclave se déroule en toute confidentialité, dans la chapelle Sixtine, où la fumée noire ou blanche devient le signal de l’issue du scrutin.
Lorsque les cardinaux ont élu un nouveau pape, la fumée blanche qui s’échappe de la cheminée du Vatican signale la fin de l’élection, et le bourdon de la basilique Saint-Pierre retentit. Ce geste millénaire est suivi de l’apparition d’un cardinal qui, depuis le balcon de la basilique, proclame l’élection du nouveau pape avec les mots « Habemus Papam ». Ce moment solennel est une occasion pour le nouveau pontife de s’adresser à la foule rassemblée en place Saint-Pierre et de prononcer sa première bénédiction « Urbi et Orbi », marquant ainsi le début de son pontificat.