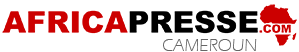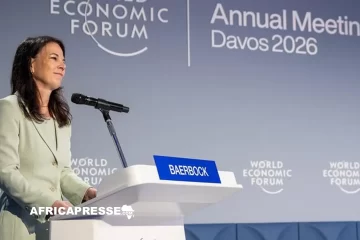Le 20 mai dernier, les autorités camerounaises ont célébré la Fête de l’unité nationale. Mais à Buea, capitale du Sud-Ouest à majorité anglophone, le contraste est saisissant. La ville, en apparence plus calme que d’autres zones du conflit, reste marquée par les répercussions d’un conflit qui dure depuis huit ans. La sécurité, l’économie locale et l’accès aux soins y sont durement affectés.
Depuis 2016, la crise anglophone oppose des groupes séparatistes armés, qui revendiquent l’indépendance du « Cameroun anglophone », aux forces gouvernementales. Si les affrontements directs se sont espacés à Buea, la violence persiste ailleurs dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les mouvements séparatistes se sont morcelés, rendant les lignes de front plus floues, et les zones d’insécurité plus imprévisibles. À Buea, ce climat instable se ressent au quotidien, même sans combats ouverts.
Le conflit trouve ses racines dans une profonde fracture historique. Ancienne colonie allemande, le Cameroun a été divisé entre administration française et britannique après la Première Guerre mondiale. À l’indépendance, le rattachement des régions anglophones à la République du Cameroun, majoritairement francophone, s’est fait sans réel consensus populaire. Depuis, les revendications d’autonomie, puis d’indépendance, n’ont cessé de croître, jusqu’à exploser en 2016 après des manifestations réprimées par l’État.
L’année 2025 est électorale au Cameroun. Un climat qui, dans les régions anglophones, ravive les tensions. Beaucoup redoutent que les scrutins soient marqués par des violences ou des boycotts dans les zones les plus instables. À Buea, si les autorités insistent sur le retour progressif à la normale, les habitants, eux, restent méfiants. Les déplacements internes augmentent, et la confiance envers l’État reste faible.
Ville universitaire et centre administratif, Buea accueille aujourd’hui un grand nombre de déplacés internes venus de localités plus exposées. Cette pression démographique pèse sur les infrastructures, déjà affaiblies. Le système de santé, en particulier, montre des signes d’essoufflement, tout comme l’économie locale, affectée par l’insécurité et la baisse des investissements. Beaucoup vivent dans une forme d’attente anxieuse, tiraillés entre résilience et incertitude.
Alors que le conflit en zone anglophone n’occupe plus la une des médias internationaux, la population locale, elle, vit toujours sous tension. Les ONG signalent une dégradation continue de la situation humanitaire. Buea offre l’image d’un conflit gelé, ni réglé ni reconnu à sa juste gravité. Un conflit devenu silencieux, mais toujours lourd de conséquences.