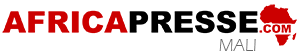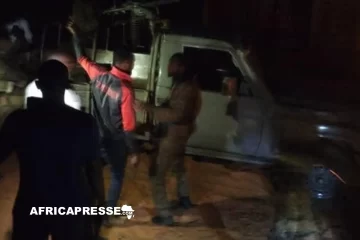Le gouvernement malien a revu à la hausse sa loi de Finances pour l’année 2025, adoptée en Conseil des ministres le 6 août, tout en parvenant à réduire son déficit prévisionnel de 40,8 milliards de francs CFA. Ce nouvel équilibre budgétaire s’inscrit dans un contexte tendu, où les besoins en matière de sécurité et de développement social restent pressants.
La révision budgétaire porte les recettes attendues à 2 739,7 milliards de francs CFA, soit une hausse de 90,8 milliards par rapport à la version initiale. Cette progression de 3,43 % s’explique notamment par une meilleure mobilisation des ressources grâce au Programme moderne de contrôles des importations, au report de recettes exceptionnelles de sociétés de téléphonie, ainsi qu’à des contributions du Fonds de soutien aux projets d’infrastructures. Côté dépenses, celles-ci augmentent également, atteignant 3 279,9 milliards, soit 50 milliards de plus, pour couvrir des besoins urgents en infrastructures et pour renforcer la sécurité intérieure.
Le nouveau déficit prévisionnel s’établit désormais à 540,2 milliards de francs CFA, contre 581 milliards dans la loi initiale. Cette réduction, bien que modeste, constitue un signal positif dans un climat économique fragilisé. Le Mali, en phase de transition politique, tente de maintenir une trajectoire budgétaire viable tout en répondant aux attentes d’une population confrontée à l’insécurité, à la précarité sociale et à un isolement régional croissant depuis le retrait du pays de plusieurs institutions ouest-africaines.
Selon les estimations du FMI, le déficit budgétaire malien a atteint 4,3 % du PIB en 2024 et devrait s’établir à 3,4 % en 2025. Ces chiffres traduisent une volonté d’assainissement, mais restent supérieurs à ceux généralement observés dans la sous-région. La Banque africaine de développement alerte, de son côté, sur le poids croissant des dépenses sécuritaires et sociales, qui continuent d’exercer une pression significative sur les équilibres publics, dans un pays dont la croissance reste tributaire de l’aide extérieure et de la stabilité politique.
Cette révision de la loi de Finances montre que le gouvernement cherche à regagner de la marge de manœuvre sans provoquer de rupture. Toutefois, l’augmentation conjointe des recettes et des dépenses interroge sur la soutenabilité de ces choix. Sans réforme structurelle des finances publiques ni amélioration durable de la mobilisation fiscale, les marges pourraient s’effriter rapidement, notamment si la situation sécuritaire venait à se dégrader.
En toile de fond, cette révision budgétaire traduit aussi une volonté politique : montrer que l’État reste fonctionnel, capable de planifier et de réagir, malgré les tensions internes et les incertitudes sur le calendrier de retour à l’ordre constitutionnel. Reste à savoir si cette dynamique pourra être tenue dans un environnement régional volatil, où l’accès aux financements extérieurs devient de plus en plus conditionné à la stabilité institutionnelle.