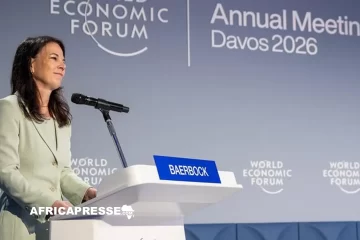Le procès de Mahamat Saïd Abdel Kani, ancien chef rebelle de la coalition Séléka, s’est achevé à la Cour Pénale Internationale (CPI). Les juges se sont retirés pour délibérer, après plus de trois années d’audiences consacrées à des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre présumés, commis en Centrafrique en 2013.
Le bureau du procureur a requis la condamnation de l’accusé sur l’ensemble des sept chefs d’accusation. Mahamat Saïd Abdel Kani est poursuivi pour son rôle présumé dans une campagne d’arrestations arbitraires, d’actes de torture et de persécutions, alors qu’il dirigeait l’Office central de répression du banditisme (OCRB) à Bangui. Les accusations s’appuient sur les témoignages de 58 personnes entendues durant le procès, décrivant une période de violences systématiques.
Ce procès s’inscrit dans le long cycle de violences et d’impunité qui déchire la Centrafrique depuis la prise de pouvoir de la Séléka en 2013. Le renversement du président François Bozizé par cette coalition majoritairement musulmane avait plongé le pays dans une guerre civile aux dimensions confessionnelles, opposant la Séléka aux anti-balaka, des milices majoritairement chrétiennes. La CPI est intervenue après que l’état de droit se soit effondré, représentant un espoir de justice pour des milliers de victimes.
Le verdict, attendu dans les mois à venir, est très anticipé. Une condamnation serait perçue comme un signal fort contre l’impunité des chefs de milice et renforcerait la légitimité de la CPI en Centrafrique. Toutefois, une relaxe ou un acquittement pourrait être interprété comme un échec de la justice internationale et risquerait d’alimenter un ressentiment dans un pays encore profondément divisé. Ce jugement intervient à un moment politique sensible pour la Centrafrique, alors que le pays tente de consolider un processus de paix fragile.
Lors de sa plaidoirie, le procureur adjoint Mandiaye Niang a établi un lien direct entre ce procès et l’actualité centrafricaine. Il a souligné la symbolique de cette clôture judiciaire à l’approche d’élections, estimant que la CPI était “au rendez-vous” pour rappeler que “la conquête ou la conservation du pouvoir ne saurait justifier le massacre d’une partie de la population”. Ce discours souligne la volonté de la Cour d’ancrer son action dans une logique de dissuasion et de contribution à la réconciliation nationale.
Les représentants des 32 victimes civiles constituées parties civiles dans ce procès se sont alignés sur les réquisitions du procureur, réclamant également une condamnation. Leur présence à La Haye illustre la dimension réparatrice que peut incarner la justice internationale pour ceux qui ont directement subi les atrocités. La parole est désormais à la défense de Mahamat Saïd Abdel Kani, qui présentera ses arguments avant que les juges ne rendent leur décision, marquant l’ultime étape de cette procédure judiciaire historique.