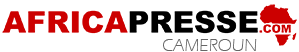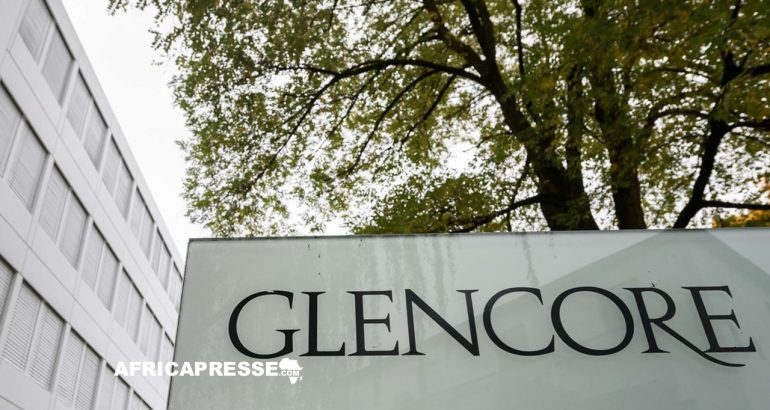L’affaire Glencore, impliquant plus de 11 millions de dollars de pots-de-vin versés à des responsables camerounais de la SNH et de la Sonara entre 2011 et 2018, continue de peser lourdement sur le pays. Si le procès doit s’ouvrir à Londres en juin 2027, les conséquences sont déjà visibles à Yaoundé : recul de la production pétrolière, perte de compétitivité et réputation ternie.
Selon l’économiste Serge Godong, ce scandale symbolise le déclin institutionnel du Cameroun. Il souligne que le pays a perdu du terrain sur l’échiquier africain en matière d’investissements directs étrangers. Classé seulement 28e sur le continent, le Cameroun se retrouve loin de l’image de locomotive économique que ses autorités aiment entretenir. La gouvernance, déjà fragilisée, ressort davantage discréditée aux yeux des investisseurs.
En 2022, Paul Biya avait autorisé la SNH à saisir le Tribunal criminel spécial. Deux ans plus tard, aucune enquête n’a été rendue publique. Pour Henri Njoh Manga Bell, président de Transparency International Cameroon, cette inertie révèle une justice sous influence. Des personnalités impliquées seraient encore en fonction, freinant volontairement toute investigation locale. Les regards se tournent donc vers la justice britannique, perçue comme plus crédible que les institutions nationales.
Les pots-de-vin auraient permis à Glencore d’acquérir le pétrole camerounais à près de 30 % en dessous du prix du marché. Les pertes sont considérables mais impossibles à quantifier sans enquête officielle. Pour Alain Nkoyock, expert en gouvernance, seule une volonté politique claire permettrait d’espérer un recouvrement. Il appelle à une coopération internationale forte et à la création d’un bureau spécialisé sur la restitution des avoirs volés, à l’image du modèle nigérian.
En août dernier, l’administration fiscale a notifié à Glencore une dette de près de 11 000 milliards de FCFA, correspondant à des droits et taxes non acquittés. Mais l’absence d’un cadre national solide et l’attentisme judiciaire rendent improbable un règlement rapide. Sans réforme institutionnelle ni pression de la société civile, le Cameroun risque de voir ce dossier s’enliser, avec un coût durable pour ses finances publiques.
Au-delà des pertes économiques, l’affaire Glencore met à nu la fragilité de l’État face à la corruption à haut niveau. Elle interroge sur la capacité du pouvoir à rompre avec l’impunité et à défendre l’intérêt national. Pour de nombreux observateurs, ce dossier sera jugé autant dans les tribunaux étrangers que dans l’opinion publique camerounaise, où il symbolise la faillite d’un système.