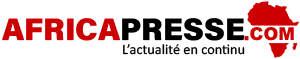Le 31 janvier 2026 à Los Angeles, Fela Kuti est devenu le premier Africain à recevoir à titre posthume un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière. Ce “Lifetime Achievement Award” décerné par la Recording Academy consacre l’homme qui a inventé l’Afrobeat, ce mélange explosif de jazz, de highlife et de rythmes traditionnels qui a fait danser le monde entier. Mais le paradoxe est saisissant : celui qui a passé sa vie à conspuer l’ordre établi et les institutions reçoit aujourd’hui leurs plus hautes distinctions.
Car Fela Kuti n’était pas qu’un musicien de génie. Il était aussi, et peut-être d’abord, une conscience politique, une voix qui a porté les colères et les espoirs de tout un continent. Né en 1938 à Abeokuta dans une famille d’intellectuels engagés – sa mère Funmilayo Ransome-Kuti était une figure majeure des luttes anticoloniales –, il a très tôt manifesté une rébellion viscérale contre toute forme d’autorité. Surnommé “Abami Eda” (“l’Étrange”) par sa famille, il n’a cessé de défier les règles, que ce soit en volant l’argent de ses parents ou en menant ses camarades d’école à l’assaut d’un stade dont la police bloquait l’entrée. Cette révolte enfantine deviendra le moteur de toute une vie.
C’est à Londres, au Trinity College of Music, que le jeune homme découvre le jazz et façonne son art. Puis vient l’Amérique en 1969. Là-bas, le choc est double. D’une part, il mesure la dureté du sort réservé aux musiciens noirs, réduits à survivre sans permis de travail. D’autre part, sa rencontre avec Sandra Smith, une militante des Black Panthers, lui ouvre les yeux sur l’histoire de l’esclavage et la condition noire dans le monde. “C’est l’Amérique qui m’a ramené à moi-même”, confiera-t-il. De retour à Lagos, Fela métamorphose sa musique : il troque la trompette pour le saxophone, chante en pidgin et pose les fondations de l’Afrobeat. Les titres s’enchaînent, les foules se déchaînent. L’Africa Shrine, son club mythique, devient un temple du panafricanisme où se croisent musiciens, militants et révolutionnaires.
La consécration mondiale s’accompagne d’une confrontation permanente avec le pouvoir nigérian. En 1977, la sortie du titre “Zombie” – où il compare les soldats à des automates – déclenche une riposte féroce. Un millier de militaires attaquent sa résidence, Kalakuta Republik, détruisent tout, violent, brûlent. Sa mère, Funmilayo, est défenestrée et succombera à ses blessures. Fela porte son cercueil jusqu’au quartier général de la junte, puis transforme sa douleur en œuvre : “Coffin for Head of State”, “Sorrow, Tears and Blood” deviennent des preuves musicales à charge contre la violence d’État. Emprisonné à plusieurs reprises, notamment en 1984 pour trafic de devises dans une affaire qu’Amnesty International qualifie de politiquement motivée, il ne cède jamais. Le “Black President” – surnom que lui avait donné la foule – reste debout, même quand le sida commence à ronger son corps.
Aujourd’hui, l’héritage de Fela Kuti dépasse largement le cadre musical. Ses fils, Femi et Seun, perpétuent la flamme à la tête d’Egypt 80. Mais plus largement, toute la scène afrobeats contemporaine – de Burna Boy, petit-fils de son premier manager, à Wizkid, Davido ou Tems – marche dans un sillon qu’il a creusé. Ce n’est pas tant une filiation stylistique qu’une dette d’existence : avant Fela, la musique nigériane n’avait pas cette ambition planétaire, cette capacité à mordre le monde. En 2025, “Zombie” est entré au Grammy Hall of Fame. Un an plus tard, c’est l’homme tout entier que l’institution américaine a choisi de célébrer. Trop tard pour lui, sans doute. Mais à temps pour rappeler que les insoumis finissent parfois par incarner l’ordre, celui des légendes.