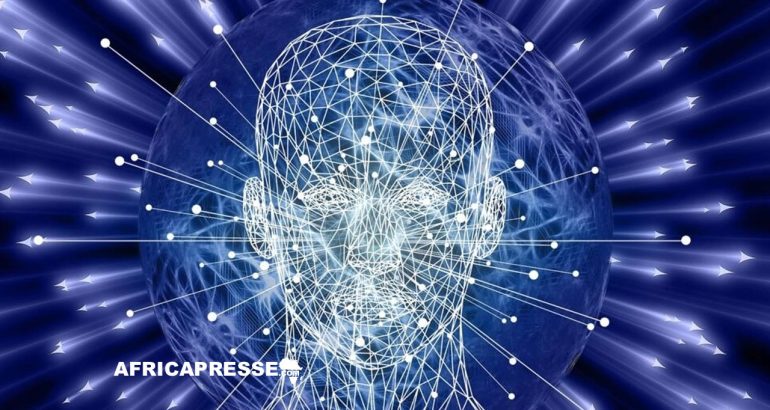L’Intelligence Artificielle (IA) est un secteur en pleine croissance, notamment grâce au rôle clé des annotateurs de données, ces « petites mains » qui permettent aux machines d’apprendre à reconnaître des images et des textes. De plus en plus nombreux en Afrique, ces travailleurs sont essentiels à la formation des IA, bien que souvent invisibles et mal rémunérés. Cette réalité prend de l’ampleur à Madagascar et au Kenya, deux pays où cette activité s’est fortement développée ces dernières années.
Les annotateurs de données, comme Ephantus Kanyugi au Kenya, décrivent un travail à la fois répétitif et parfois éprouvant. Leur tâche consiste à classer, qualifier et détailler des images, afin que les algorithmes d’IA puissent les analyser. Ce travail est indispensable, par exemple, pour les véhicules autonomes qui doivent savoir identifier des panneaux de signalisation ou reconnaître des obstacles. Toutefois, ce secteur est marqué par des conditions de travail précaires, des rémunérations dérisoires et une exposition à des contenus parfois traumatisants, comme l’explique Ephantus : « un jour, on annote des voitures, le lendemain, des corps décédés ». Ces aspects rendent le travail particulièrement difficile pour de nombreux annotateurs, malgré son importance pour l’essor des technologies d’IA.
En dépit de ces conditions, l’annotation de données est devenue un secteur stratégique, particulièrement en Afrique, où la main-d’œuvre est abondante et peu coûteuse. Le Kenya, par exemple, est un acteur monté en puissance dans ce domaine. Cependant, ce succès est terni par l’absence de régulations adéquates, ce qui a conduit les travailleurs à organiser des pétitions auprès du gouvernement pour revendiquer de meilleures conditions. À Madagascar, l’annotation de données s’est également imposée comme une spécialité, notamment dans le domaine de la gestion de données satellitaires et médicales, donnant ainsi à ce pays une place de choix dans le secteur mondial de l’IA.
Les perspectives pour ces travailleurs sont incertaines, mais plusieurs initiatives pourraient améliorer leur situation. Au Kenya, une pétition visant à améliorer les conditions de travail et à garantir une rémunération juste a déjà été déposée. Les annotateurs réclament un salaire équitable, des horaires plus humains et un soutien psychologique face aux contenus traumatisants qu’ils sont amenés à traiter. Ces démarches ont pour but de faire reconnaître l’importance de leur rôle et de défendre leurs droits, dans un secteur où leurs contributions sont pourtant cruciales pour l’évolution des technologies.
Les témoignages d’annotateurs comme Ephantus Kanyugi et Joan Kinyua, présidente d’une association d’annotateurs kenyans, soulignent l’urgence de réformer un secteur qui génère pourtant des millions de dollars pour les entreprises de technologie. Joan Kinyua insiste : « Nous demandons une paie équitable, des conditions de travail raisonnables et un soutien psychologique ». Elle précise que leur démarche n’est pas contre les emplois créés par l’IA, mais pour qu’ils soient exercés dans des conditions décentes.
À Madagascar, l’annotation de données est un secteur en plein boom, offrant une alternative intéressante face au chômage des jeunes diplômés. Le pays a su se faire une place dans l’écosystème mondial de l’IA, en particulier grâce à la spécialisation de ses travailleurs. Les entreprises locales ont su s’entourer de jeunes talents, souvent diplômés, qui se distinguent par leur expertise dans des domaines techniques comme l’observation satellite ou le « Medtech ». Ce modèle est un exemple de la manière dont les pays africains peuvent s’insérer dans les chaînes de valeur de l’IA tout en formant des jeunes talents aux compétences recherchées à l’international.