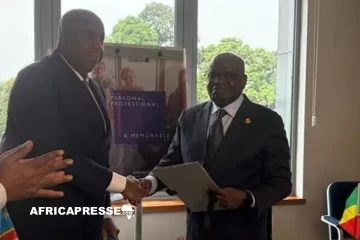Le gouvernement malgache a annoncé, le 24 octobre, la perte de la nationalité malgache d’Andry Rajoelina, ancien président de la République. Le décret, signé par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo et publié au Journal officiel, confirme que l’ex-chef de l’État ne conserve plus que sa nationalité française. Cette décision, inédite dans l’histoire politique récente du pays, marque une rupture symbolique forte avec celui qui a dirigé Madagascar à deux reprises.
La décision repose sur l’article 42 du code de nationalité malgache de 1960, qui stipule qu’un citoyen perd sa nationalité s’il acquiert volontairement une nationalité étrangère. En 2014, Andry Rajoelina avait obtenu la nationalité française par naturalisation, selon un décret signé par le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls. Cette acquisition, volontaire et personnelle, suffit légalement à entraîner la perte de la nationalité malgache.
Pendant près d’une décennie, Rajoelina avait gardé secrète sa double nationalité. Ce n’est qu’en juin 2023, à quelques mois de l’élection présidentielle, que la révélation de sa naturalisation française a éclaté au grand jour. L’affaire avait alors provoqué une onde de choc dans le paysage politique malgache, certains y voyant une trahison, d’autres un calcul opportuniste. Face aux critiques, l’ancien président avait justifié sa démarche par des raisons familiales, expliquant avoir voulu faciliter les études de ses enfants en France.
Cette perte de nationalité a des implications immédiates : Andry Rajoelina ne pourra plus se présenter à une élection présidentielle à Madagascar. La Constitution réserve en effet cette possibilité aux seuls citoyens malgaches. Cette exclusion marque un tournant dans la carrière d’un homme qui, depuis la transition de 2009, a profondément influencé la vie politique de la Grande Île. Pour certains observateurs, il s’agit d’une « fin de cycle » logique après des années de controverse sur sa légitimité.
Dans le camp de l’ancien président, la décision est vécue comme une humiliation politique. Ses partisans dénoncent une manœuvre visant à l’écarter durablement du jeu politique. D’autres, au contraire, saluent une application stricte de la loi, perçue comme un signal fort du retour à l’État de droit. À court terme, cette décision pourrait rebattre les cartes du paysage politique malgache, déjà fragilisé par les divisions internes et la perte de confiance envers les institutions.
Au-delà du cas Rajoelina, cette affaire interroge sur la solidité juridique et morale du système politique malgache. La dissimulation d’une double nationalité pendant plusieurs années, sans conséquence institutionnelle, montre les failles des mécanismes de transparence et de contrôle. La perte officielle de nationalité, aujourd’hui actée, apparaît moins comme un acte de justice tardive que comme le révélateur d’un dysfonctionnement profond entre la légalité, la morale et la pratique du pouvoir à Madagascar.