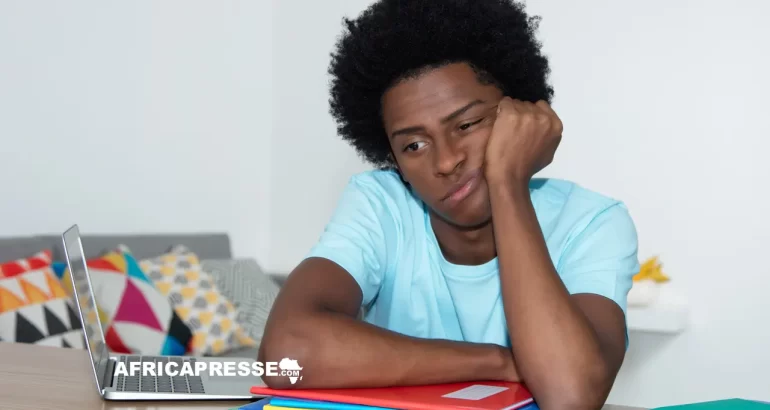Depuis la pandémie, de nombreux étudiants africains, inscrits dans les cégeps du Québec, ont été victimes des promesses trompeuses d’agences malhonnêtes, et se sont retrouvés dans une situation financière dramatique. Pensant bénéficier de la gratuité scolaire, certains ont dû rentrer précipitamment dans leur pays d’origine, faute de moyens financiers pour payer leurs études et leur vie au Québec. Ces étudiants, une fois arrivés, se sont heurtés à la dure réalité du coût des études, qui varie entre 7 000 et 12 000 $ par session. La désillusion a été grande.
L’essor du recrutement d’étudiants africains dans les cégeps québécois a souvent été facilité par des agences de recrutement, qui, loin d’apporter un service honnête, ont induit les candidats en erreur sur les conditions réelles de leur séjour au Canada. Ces agences ont présenté le Québec comme un terreau fertile pour l’éducation gratuite, notamment en exagérant les possibilités de bourses et d’aides financières. Cependant, ces informations étaient erronées, comme l’illustre le cas du Cégep de Jonquière, où le nombre de candidatures africaines a quadruplé entre 2020 et 2024, sans que les étudiants ne soient informés correctement des coûts réels associés à leurs études.
Les réseaux malveillants ne se sont pas limités aux cégeps. Depuis la pandémie, le Canada a connu une explosion des inscriptions en provenance d’Afrique, alimentée par une désinformation généralisée. Plusieurs universités canadiennes ont été elles aussi confrontées à ces réseaux criminels, mais les cégeps n’ont pas été épargnés. En effet, bien que la majorité des établissements n’aient pas de liens directs avec les agences, ces dernières ont parfois manipule des familles africaines en diffusant de fausses informations sur des exemptions de frais de scolarité, créant ainsi un afflux d’étudiants mal préparés à la réalité financière de leurs études au Québec.
Face à cette situation de détresse, les cégeps ont dû adapter leurs pratiques pour mieux encadrer les étudiants internationaux. À Jonquière, des mesures telles que des services psychosociaux, des prêts d’urgence, et des cours de mise à niveau en français ont été mises en place pour aider les étudiants en difficulté. De plus, un dépôt substantiel de 7 500 $ a été instauré avant l’arrivée des nouveaux étudiants afin de garantir qu’ils aient les ressources nécessaires pour financer leur première session. Ces initiatives visent à éviter que d’autres jeunes se retrouvent dans la même situation dramatique.
Les efforts pour remédier à cette crise ont permis d’améliorer la situation, mais il est évident que la crise n’est pas complètement résorbée. L’intensification des communications avec les étudiants avant leur arrivée au Québec et la clarification des coûts réels associés à leurs études ont permis de mieux préparer les futurs étudiants africains. Cependant, certains défis persistent, notamment le manque de vérification des ressources financières lors des demandes de permis d’études. Une révision des politiques gouvernementales s’avère essentielle pour éviter que ces jeunes talents ne soient de nouveau dupés.
Malgré les obstacles, de nombreux étudiants africains ont surmonté les difficultés et ont réussi à s’intégrer et à poursuivre leurs études au Québec. Des histoires inspirantes émergent, telles que celle d’étudiants qui, après avoir traversé des épreuves, ont trouvé des stages et réussi à financer leurs études. Ces réussites témoignent du potentiel de ces jeunes, mais soulignent aussi les défis qu’ils ont dû surmonter pour parvenir à leurs fins, souvent avec le soutien des communautés collégiales locales.