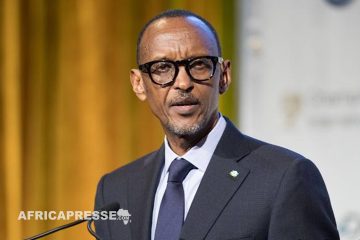Le 27 mars 2025, Kigali a pris la décision d’interdire toute coopération, partenariat et financement avec les institutions belges pour les organisations non gouvernementales (ONG), religieuses ou fondations opérant sur le sol rwandais. Cette mesure, prise immédiatement après la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique, met en péril les activités de nombreuses structures locales soutenues par la Belgique, au risque de perdre leur licence si elles ne respectent pas cette directive. Les organisations concernées sont particulièrement inquiètes des conséquences de cette interdiction sur leurs programmes en cours.
La nouvelle décision a particulièrement surpris les responsables des ONG belges et des fondations partenaires du Rwanda, qui n’avaient pas anticipé que la rupture diplomatique affecterait aussi les acteurs de la société civile. Nombre d’entre elles, qui bénéficient du soutien financier et technique de la Belgique, se retrouvent désormais dans l’incertitude. Par exemple, plusieurs projets sont suspendus en attendant de trouver de nouveaux financements. « Nous ne savions pas que la décision de couper les liens diplomatiques affecterait autant nos activités », explique un responsable d’ONG. Cette décision pourrait compromettre des années de travail et de financement, dans un contexte déjà difficile.
Cette interdiction intervient après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre les deux pays. La Belgique avait été un partenaire clé du Rwanda dans de nombreux domaines, notamment dans la santé, l’agriculture et l’urbanisation. Enabel, l’agence belge de développement, avait prévu un budget de 95 millions d’euros pour ces projets jusqu’en 2029, ainsi que 17 millions d’euros pour des initiatives liées à la protection sociale. La rupture des relations diplomatiques, survenue dans un contexte déjà tendu, a donc des conséquences profondes sur l’efficacité des programmes de développement mis en place au Rwanda, fragilisant particulièrement les ONG.
Face à cette situation, les autorités rwandaises semblent sereines. Le ministre rwandais des Finances, Yusuf Murangwa, a assuré que les secteurs critiques impactés par cette mesure seraient couverts par l’État rwandais. Il a ajouté que le gouvernement mettrait en place des solutions pour pallier les manques de financement, notamment en réorientant les fonds nationaux. Toutefois, plusieurs organisations craignent que la rupture des relations diplomatiques ne soit qu’un premier signal, redoutant que d’autres pays suivent la même voie.
La situation devient d’autant plus complexe pour certaines ONG qui ont déjà été impactées par la suspension des aides américaines. L’incertitude plane désormais sur la continuité de leurs programmes, et certains responsables d’organisations admettent être dans l’incapacité de planifier à long terme. « Il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de cette interdiction, mais la situation est préoccupante », déclare le directeur d’une organisation rwandaise. Les ONG locales devront naviguer dans un contexte de plus en plus incertain et chercher d’autres partenaires pour assurer la poursuite de leurs missions.
Enfin, cette interdiction soulève également des questions sur l’avenir de la société civile rwandaise. Les ONG jouent un rôle central dans la mise en œuvre de projets de développement durable, de défense des droits humains et de lutte contre la pauvreté. Leur fragilisation pourrait freiner les efforts de développement du pays et nuire à la réputation du Rwanda sur la scène internationale. La réponse du gouvernement rwandais, bien qu’assurée, reste à observer sur le long terme, tandis que l’avenir de ces organisations dépendra largement de leur capacité à se réorienter financièrement et politiquement.