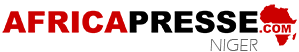La Russie a franchi une étape décisive dans sa stratégie de pénétration énergétique en Afrique en signant, le 28 juillet, un mémorandum de coopération dans le nucléaire civil avec le Niger. Cet accord, paraphé entre le géant russe Rosatom et le ministère nigérien de l’Énergie lors de la visite officielle du ministre russe de l’Énergie Sergeï Tsivilev à Niamey, ambitionne de “rendre l’électricité accessible” à l’ensemble des Nigériens. L’initiative dépasse largement le cadre traditionnel de l’exploitation uranifère pour embrasser une vision globale du développement énergétique du pays.
L’accord transcende la simple extraction minière d’uranium, ressource dont le Niger est l’un des premiers producteurs mondiaux. Moscou propose de “créer tout un système pour le développement de l’énergie atomique pacifique”, selon les termes du ministère russe de l’Énergie. Ce projet englobe la construction d’installations de production électrique, le développement de la médecine nucléaire et la formation de spécialistes nigériens. Cette approche holistique révèle la volonté russe de créer un écosystème énergétique complet, potentiellement générateur d’une dépendance technologique à long terme.
Le Niger, malgré ses importantes réserves d’uranium, demeure l’un des pays les moins électrifiés au monde, avec un taux d’accès à l’électricité inférieur à 20%. Cette situation paradoxale s’explique par des décennies de politique extractive où les ressources étaient exportées sans bénéfice énergétique local. Depuis le coup d’État de juillet 2023 qui a porté le général Abdourahamane Tiani au pouvoir, Niamey cherche à diversifier ses partenariats, s’éloignant progressivement de la France et de l’Occident. Cette réorientation géopolitique s’inscrit dans une dynamique sahélienne plus large, où la Russie gagne en influence aux dépens des puissances traditionnelles.
L’accord ouvre la voie à une potentielle autonomie énergétique pour le Niger, mais soulève des interrogations majeures. La maîtrise de la technologie nucléaire civile pourrait théoriquement permettre au pays de valoriser localement ses réserves d’uranium et de répondre à ses besoins électriques croissants. Cependant, les défis sont considérables : coûts d’infrastructure, expertise technique, sécurité nucléaire et gestion des déchets radioactifs. La création annoncée d’une commission intergouvernementale sur le commerce et l’économie entre les deux pays devrait préciser les modalités concrètes de cette coopération.
La visite de la délégation russe, composée de représentants des ministères de la Défense, de l’Énergie, des Finances, de l’Industrie, des Transports et de l’Éducation, ainsi que d’entreprises phares comme Rosatom, Sberbank, KamAZ et Roscosmos, témoigne d’une approche diplomatique globale. Les entretiens entre le vice-ministre russe de la Défense Yunus-Bek Yevkurov et le ministre nigérien de la Défense Salifou Modi révèlent une dimension sécuritaire non négligeable de cette coopération, dans un contexte sahélien marqué par l’instabilité.
Cette offensive russe au Niger s’inscrit dans une stratégie plus vaste de reconquête de l’influence soviétique en Afrique. La poursuite de la tournée vers Bamako confirme cette approche régionale, visant à consolider un axe russo-sahélien concurrent de l’influence occidentale. Pour le Niger, ce partenariat représente un pari risqué : celui de troquer une dépendance historique contre une nouvelle, potentiellement plus contraignante. L’enjeu pour Niamey sera de préserver sa marge de manœuvre tout en tirant profit de cette coopération énergétique inédite.