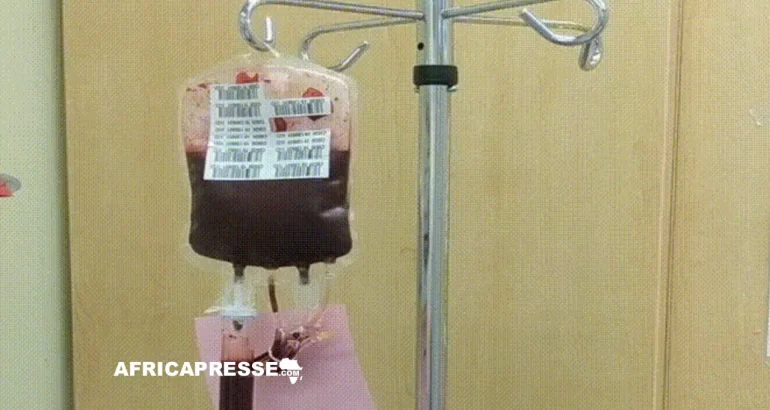Une équipe britannique a identifié fin 2024 un nouveau groupe sanguin rare, une avancée majeure pour la sécurité transfusionnelle mondiale. Pourtant, en Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest, cette découverte peine à être intégrée dans les pratiques médicales, faute d’équipements adaptés et de protocoles avancés.
Selon Salam Sawadogo, enseignant-chercheur burkinabè au Centre national de transfusion sanguine et à l’université Joseph Ki-Zerbo, les infrastructures limitées des centres de transfusion dans la région empêchent une application rapide de ces nouvelles données. Actuellement, les protocoles locaux se concentrent sur la détermination des groupes sanguins ABO et Rhésus D, minimisant la recherche d’anticorps irréguliers, souvent coûteuse et peu systématique.
Cette découverte s’inscrit dans un contexte scientifique plus large, où les groupes sanguins, au-delà des traditionnels ABO et Rhésus, sont de plus en plus précisés. Le nouveau groupe sanguin identifié, appelé AnWj négatif, correspond à l’absence de l’antigène AnWj, liée à une mutation du gène MAL. Cet antigène, présent chez 99,9 % de la population, a fait l’objet d’une énigme depuis sa découverte en 1972, désormais élucidée par les chercheurs britanniques.
Les perspectives ouvertes par cette avancée sont considérables. L’identification précise de ce nouveau groupe permet d’affiner la compatibilité sanguine, réduisant le risque d’allo-immunisation, c’est-à-dire de réactions immunitaires graves lors des transfusions. Cela revêt une importance particulière pour les patients polytransfusés, les femmes enceintes à risque et les interventions chirurgicales complexes.
Toutefois, des experts africains insistent sur la nécessité d’investir dans la modernisation des laboratoires d’immuno-hématologie et d’adapter les pratiques cliniques. Gatien Lokossou, spécialiste béninois, souligne que l’étude approfondie des mutations génétiques dans les groupes sanguins pourrait faire émerger de nouveaux sous-groupes, précisant la complexité immunologique des populations africaines. À terme, ces recherches pourraient améliorer la sécurité transfusionnelle sur le continent et réduire les risques de rejet lors de greffes.
En somme, comme le rappelle Samah Awad ALSubhi, chercheuse en immunogénétique à l’Université Umm Al-Qura, ces découvertes transcendent les frontières et nourrissent notre compréhension des diversités génétiques humaines. Leur intégration dans les systèmes de santé africains demeure cependant un défi majeur, nécessitant une volonté politique et des ressources pour mieux protéger les patients.