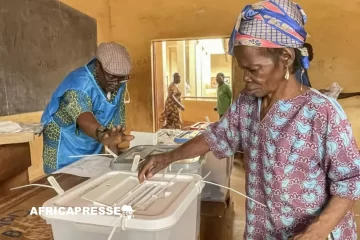Réunis ce 15 juillet à Bogota à l’initiative du Groupe de La Haye, une trentaine de pays issus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine entendent annoncer des mesures concrètes pour répondre aux violations du droit international commises par Israël à Gaza. Cette conférence intervient alors que les négociations de cessez-le-feu piétinent et que le bilan humain dépasse les 58 000 morts, majoritairement des civils.
Contrairement aux déclarations diplomatiques habituelles, les pays du Groupe de La Haye souhaitent mettre en œuvre des actions coordonnées : embargo sur les armes, soutien aux mandats de la CPI contre des responsables israéliens, et appui à la résolution onusienne exigeant la fin de l’occupation d’ici septembre 2025. L’Afrique du Sud et la Colombie, co-présidentes du groupe, espèrent fédérer de nouveaux partenaires autour de ces initiatives pour briser l’impunité dont bénéficie Israël, malgré les textes internationaux.
Le Groupe de La Haye est né en janvier 2025 de l’alliance de neuf pays (dont le Sénégal, la Malaisie et la Namibie) autour d’une même frustration : la passivité du système international face aux crimes commis à Gaza. À l’image de la mobilisation contre l’apartheid sud-africain dans les années 1970, les initiateurs misent sur l’action collective des États du Sud global pour imposer des limites juridiques à la logique de puissance. L’exemple sud-africain de l’époque – avec un embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité en 1977 – sert ici de référence historique.
La conférence de Bogota marque une tentative inédite de construire une coalition juridico-diplomatique en dehors des grands blocs occidentaux. Si certains pays – comme le Bélize – ont déjà renoncé sous pression, d’autres, tels que le Brésil, l’Algérie ou l’Irlande, répondent présents. La France, invitée, n’a pas encore donné suite. La fragilité de ce regroupement reste réelle, mais sa portée symbolique est forte : pour les organisateurs, c’est moins l’unanimité que l’audace collective qui compte.
L’ambition du sommet dépasse la seule question palestinienne. Il s’agit, selon le président colombien Gustavo Petro, de défendre une vision du droit international menacé par la montée des rapports de force. Il invite les pays participants à « couper les ponts entre leurs tribunaux, leurs ports et leurs usines » avec les pays impliqués dans le conflit, afin de réaffirmer la primauté du droit sur la force. Ce positionnement frontal fait écho aux divisions géopolitiques actuelles, où chaque initiative multilatérale se heurte à des intérêts puissants.
30 states attending Emergency meeting in Bogotá on Gaza. Urgent, overdue, historic
— Guillaume Long (@GuillaumeLong) July 12, 2025
Alors que des membres de l’ONU comme Francesca Albanese (rapporteur spécial sur la Palestine) font l’objet de menaces de sanctions par les États-Unis, la conférence de Bogota cristallise un bras de fer plus large entre partisans d’une justice internationale active et ceux qui en contestent la légitimité. Plusieurs pays invités ont préféré se désister, redoutant des représailles politiques ou économiques. Mais pour Guillaume Long, conseiller du Groupe de La Haye, c’est précisément ce type de pressions qui renforce l’urgence d’agir collectivement.
Alors que les 2,3 millions d’habitants de Gaza survivent dans une enclave ravagée et coupée du monde, les démarches engagées à Bogota se veulent un électrochoc. À l’opposé d’un sommet symbolique ou d’une tribune diplomatique de plus, l’objectif est clair : appliquer le droit existant, sans en créer de nouveau, et rappeler aux États leur responsabilité directe. Une manière, aussi, de juger la sincérité de l’attachement au droit international universel. Pour beaucoup, il s’agit d’un tournant décisif : ou bien la communauté internationale se dote de moyens concrets pour faire respecter ses principes, ou bien elle les abandonne.